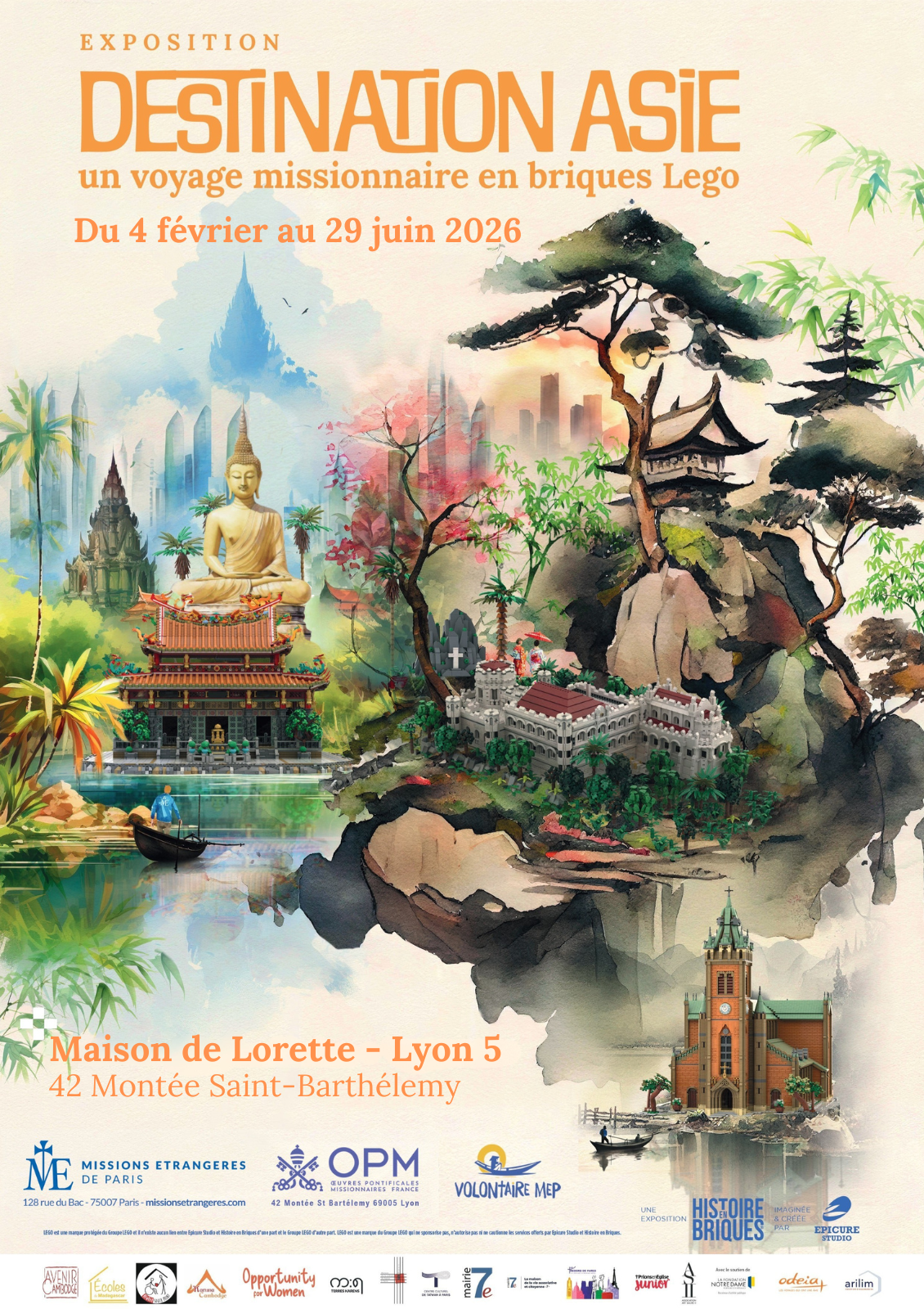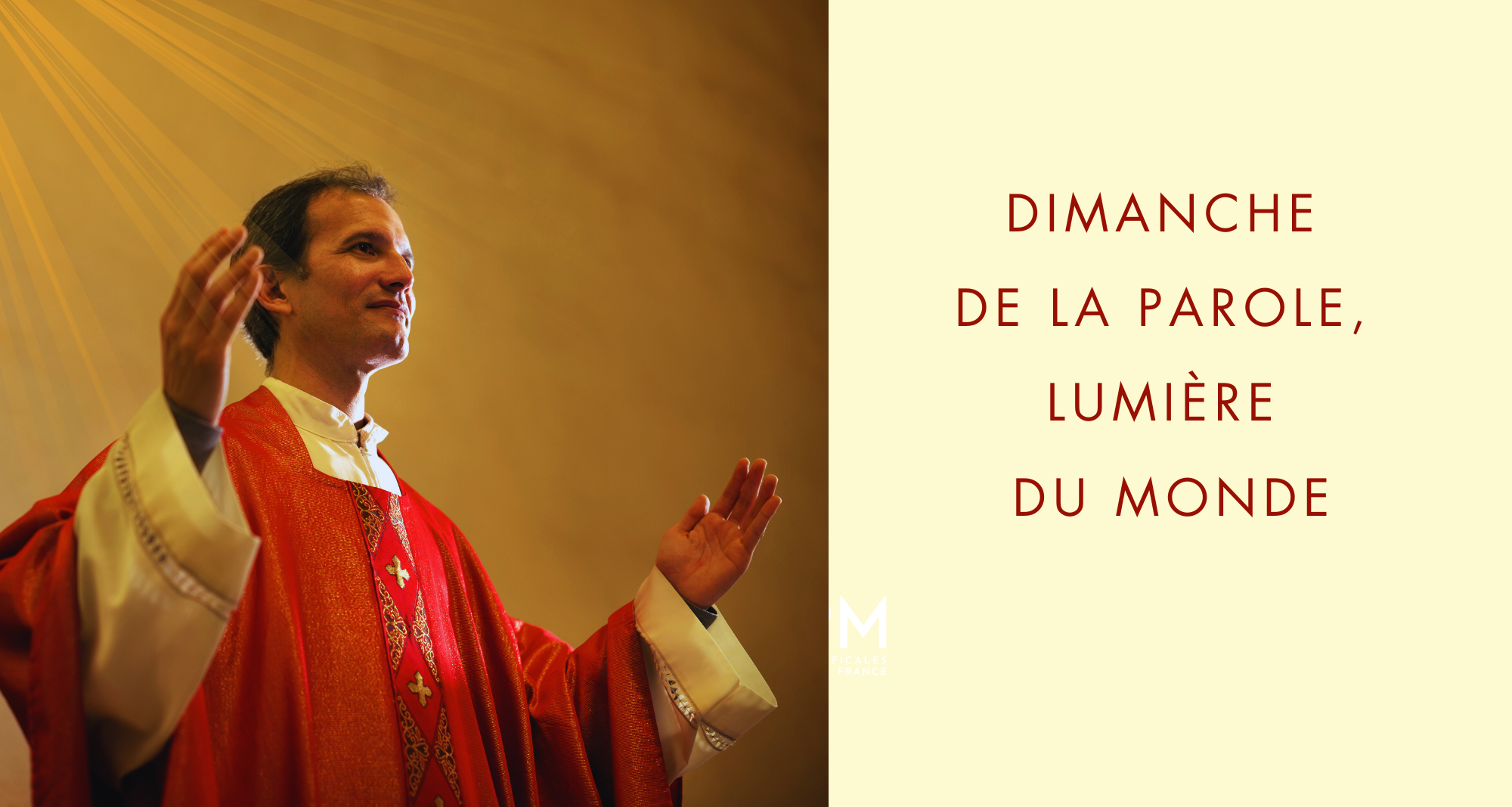Chaque dimanche ou Solennité, le Père Anh Nhue Nguyen, secrétaire général à Rome de l’Union Pontificale Missionnaire, livre à notre réflexion un commentaire missionnaire biblique.
30ème dimanche du Temps Ordinaire (Année C) – Si 35,15b-17.20-22a; Ps 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18, 9-14
L’Evangile d’aujourd’hui nous propose une des pages les plus lumineuses et en même temps les plus provocatrices de tout le message de Jésus. Deux hommes vont au temple pour prier. Tous les deux sont croyants, tous les deux cherchent Dieu et se présentent devant le Très-Haut. Mais leurs prières montrent deux manières très différentes de comprendre la foi, la justice et la relation avec le Seigneur. Cette page de l’Evangile nous offre une leçon importante pour la vie et la spiritualité de chaque disciple du Christ, appelé à devenir toujours plus missionnaire de l’espérance parmi les peuples.
1. Le pharisien et la caricature de la prière
Le pharisien représente celui qui se sent « à sa place » devant Dieu. Sa prière commence bien – “Ô Dieu je te remercie” mais immédiatement elle se transforme en une liste de mérites ; « Je ne suis pas comme les autres hommes… Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième… ». Ses mots ne montrent pas un cœur reconnaissant mais un cœur que se mesure à lui-même et se compare aux autres.
Il est intéressant de noter que le pharisien ne demande rien à Dieu, parce qu’il croit qu’il n’a besoin de rien. Sa justice devient de l’orgueil, et sa piété un mur qui le sépare du prochain. Dans sa prière, Dieu n’est pas un interlocuteur mais un spectateur. Le pharisien ne prie pas devant Dieu mais il prie sur lui-même.
A ce sujet, loin de nous l’idée de généraliser ce cas, comme si tous les pharisiens étaient ainsi ou comme s’ils priaient ou se comportaient tous ainsi. Non, non et non (il suffit pour cela de penser à des pharisiens comme Nicodème ou Joseph d’Arimathie). Le pharisien de notre parabole est seulement un exemple pour nous mettre en garde contre une attitude dangereuse pour celui qui se considère comme « pieux » devant Dieu. C’est une tentation constante aussi pour nous, hommes et femmes d’Eglise. Lorsque la vie spirituelle devient un concours de perfection, lorsque le service missionnaire se transforme en un motif de vantardise, et lorsque l’appartenance ecclésiale nous fait nous sentir « meilleurs » que les autres, alors, comme le pharisien, nous parlons seulement à nous-mêmes.
2. Le publicain : la prière qui naît de la vérité
Le publicain, par contre, reste à distance. Il n’ose pas lever les yeux, n’égrène pas ses propres mérites, ne se justifie pas. Il se frappe la poitrine et il prononce seulement une courte incantation : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! »
C’est la prière qui touche le cœur de Dieu, parce qu’elle naît de la reconnaissance de la vérité. Le publicain ne nie pas son propre péché, mais il le confie à la miséricorde de Dieu. Chez lui, pas de prétention, mais de la confiance ; pas de vanité, mais de l’humilité : pas d’enfermement mais une ouverture au pardon.
Jésus dit justement sur cet homme ; « ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste ». La justice de Dieu n’est pas un prix pour celui qui est parfait, mais un don pour celui qui se laisse aimer. Le publicain n’a pas changé le monde, mais il a laissé Dieu changer son cœur. C’est justement ça le début de la mission d’évangélisation que Dieu veut accomplir pour chaque croyant, et à travers lui/elle, pour toute l’humanité.
3. L’humilité comme chemin missionnaire
La conclusion de Jésus, « qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé », n’est pas seulement une maxime morale, mais une vérité spirituelle profonde ; l’humilité est la porte par laquelle passe la grâce. Il s’agit d’un principe évangélique tellement important que Jésus le répète plusieurs fois au cours de son ministère (voir ici Lc 18,14; et aussi Lc 14,11; Mt 23,12).
Pour celui qui vit la mission, cet Evangile est une boussole. Le missionnaire n’est pas celui qui part avec la prétention de sa propre « sainteté » et l’idée de tout savoir sur Dieu, pour ensuite porter aux autres ses propres idées sur Lui. Le véritable missionnaire, en réalité, est celui qui s’abaisse, qui se met toujours en chemin, et qui se fait l’instrument humble de son amour pour tous, exactement comme le Seigneur Jésus qui, tout en étant de nature divine, s’est dépouillé de lui-même pour devenir servant de tous (cf. Fil 2,6-7). Seul celui qui se reconnaît pauvre devant le Seigneur peut annoncer la richesse de l’Evangile.
Le missionnaire authentique est comme le publicain ; il prie toujours avec un cœur contrit, conscient de sa propre indignité devant la sublime vocation et le grand honneur d’être témoin du Christ pour tous. Il est certain que l’efficacité de la mission ne dépend pas de la stratégie, de la capacité ou des chiffres, mais de la grâce divine qui opère dans le silence des cœurs. La mission n’est pas une conquête, mais une communion; elle n’est pas la supériorité mais le service ; elle n’est pas le triomphe mais le témoignage d’un Dieu qui s’est fait humble et serviteur. Une telle conscience missionnaire sera toujours source de sérénité et de force qui vient du fidèle accompagnement du Seigneur, y compris dans l’adversité. Ce que l’on peut voir dans Saint Paul, le pharisien converti et devenu missionnaire, qui témoigne à la fin de sa vie ; « [tous m’ont abandonné. …] Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent ». (Deuxième lecture)
En conclusion, cette parabole nous apprend à prier comme de vrais croyants disciples missionnaires du Christ. Prier ne signifie pas présenter à Dieu nos mérites, mais lui offrir notre vérité. C’est un perpétuel retour à la source de la miséricorde. Chaque fois que nous disons « Mon Dieu, montre-toi favorable », l’Evangile s’accomplit en nous.
Ainsi, comme le publicain, nous pouvons revenir à la maison accomplis, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes aimés. Et l’amour reçu devient mission ; annoncer aux autres que Dieu ne se lasse jamais de pardonner, que la miséricorde est plus grande que tout péché, et que l’humilité ouvre le ciel.
Seigneur Jésus,
Tu as regardé avec amour le publicain qui se frappait la poitrine,
Et Tu lui as donné la paix du pardon.
Regarde-nous aussi, Eglise en chemin pour devenir toujours plus missionnaire :
Sauve-nous de la prétention de nous sentir justes et rends-nous humbles et vrais devant Toi.
Fais que chacune de nos actions missionnaires naisse de la gratitude et non de l’orgueil ; provienne de l’amour reçu et non du devoir accompli.
Apprends-nous à prier comme le publicain, à servir comme Tu l’as fait et à vivre pour montrer au monde que la miséricorde est notre mission.
Amen.
Télécharger le commentaire et les notes
Évangile (Lc 18, 9-14)
« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien »
Alléluia. Alléluia.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19)
En ce temps-là,
à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes
et qui méprisaient les autres,
Jésus dit la parabole que voici :
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier.
L’un était pharisien,
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :
‘Mon Dieu, je te rends grâce
parce que je ne suis pas comme les autres hommes
– ils sont voleurs, injustes, adultères –,
ou encore comme ce publicain.
Je jeûne deux fois par semaine
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’
Le publicain, lui, se tenait à distance
et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ;
mais il se frappait la poitrine, en disant :
‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’
Je vous le déclare :
quand ce dernier redescendit dans sa maison,
c’est lui qui était devenu un homme juste,
plutôt que l’autre.
Qui s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé. »