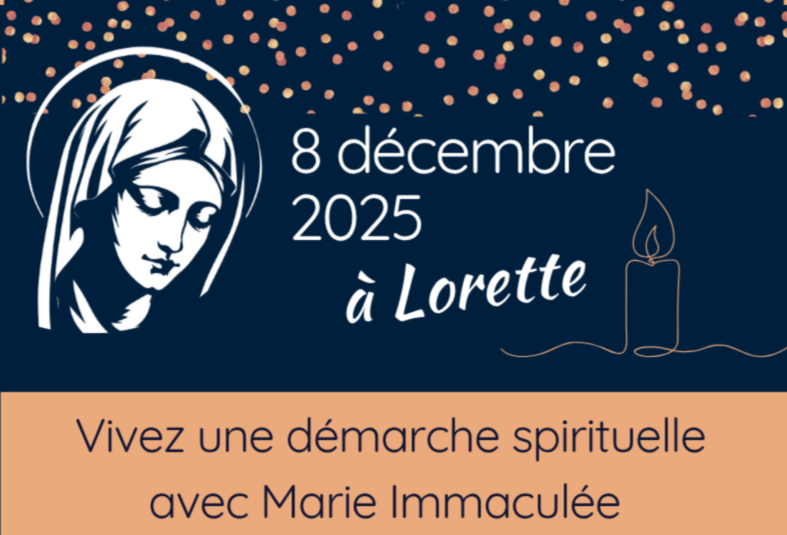Par le Cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l’évangélisation
Nous publions l’intervention prononcée par le cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l’évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières), à l’occasion du Congrès missionnaire international « La Missio ad Gentes aujourd’hui : vers de nouveaux horizons ». Organisée par le Dicastère pour l’Évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières) et les Œuvres Pontificales Missionnaires, la conférence s’est tenue dans l’après-midi du samedi 4 octobre dans la grande salle de l’Université Pontificale Urbanienne, dans le cadre du Jubilé du monde missionnaire et des migrants des 4 et 5 octobre.
Chers frères et sœurs dans le Christ, compagnons missionnaires de l’Évangile,
Au nom du Dicastère pour l’Évangélisation, de la Section pour la Première Évangélisation et les Églises particulières jeunes, de l’Université Pontificale Urbanienne et des Œuvres Pontificales Missionnaires, je vous souhaite la bienvenue à cette Rencontre missionnaire internationale à l’occasion du Jubilé du Monde Missionnaire et des Migrants qui se célèbre aujourd’hui et demain. Il est opportun et nécessaire d’étudier ensemble, de réfléchir ensemble, de s’écouter mutuellement, d’apprendre les uns des autres de manière synodale, alors que nous abordons le thème : La Missio ad Gentes aujourd’hui : vers de nouveaux horizons. En cette célébration jubilaire, laissons la vertu théologale de l’Espérance nous indiquer de nouveaux horizons.
La découverte de nouveaux horizons dans la Missio ad gentes doit être effectuée périodiquement par les Églises locales, les conférences épiscopales nationales et continentales, les sociétés missionnaires, les instituts de vie consacrée, les associations de laïcs et les mouvements ecclésiaux. Le Concile Vatican II a déjà déclaré dans AG 6 : « Pour cette activité missionnaire de l’Église, diverses situations se présentent parfois mêlées les unes aux autres : situation d’abord de début ou de plantation, puis de nouveauté ou de jeunesse. Quand tout cela est accompli, l’action missionnaire de l’Église ne cesse pas pour autant : le devoir incombe aux Églises particulières déjà formées de la continuer et de prêcher l’Évangile à tous ceux qui sont encore au-dehors. En outre, il n’est pas rare que les groupes humains au sein desquels l’Église existe, ne soient complètement transformés pour des raisons diverses ; des situations nouvelles peuvent en résulter. L’Église doit alors examiner si ces situations exigent de nouveau une activité missionnaire. »
Dans cette introduction, je vais vous proposer trois réflexions qui pourraient contribuer à animer l’esprit missionnaire et à stimuler l’imagination. Ne vous attendez pas à un traité académique exhaustif. Je souhaite simplement « penser à voix haute » avec vous. Je vais essayer de mettre en dialogue le décret du Concile Vatican II sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes, promulgué il y a soixante ans, avec certaines de nos expériences significatives.
Mission et catholicité concrète
À mon avis, ce thème qui imprègne le document conciliaire Ad gentes mérite plus d’attention qu’il n’en a reçu. Les missions du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit ont révélé la volonté de salut universel du Père. Les disciples du Christ, animés par le Saint-Esprit, partent en mission pour apporter l’Évangile à tous, à toutes les nations. L’Église naît dans les communautés et les peuples qui accueillent l’Évangile. La mission chrétienne manifeste clairement l’universalité de l’offre de salut et la catholicité de l’Église. L’Église est missionnaire par nature, car elle est à la fois le fruit de la mission et la porteuse de la mission.
Lorsque nous parlons de la catholicité de l’Église en relation avec l’universalité de la mission, nous ne traitons pas d’un simple concept ou d’un idéal romantique. Selon Ad gentes, la communion catholique est une catholicité concrète, qui implique des peuples concrets vivant dans des cultures, des histoires, des gloires, des forces, des échecs et des limites concrètes, mais unis dans une seule foi. Nous lisons dans AG 4 : « Le jour de la Pentecôte, fut préfigurée l’union des peuples dans la catholicité de la foi, par l’Église de la Nouvelle Alliance, qui parle toutes les langues, comprend et embrasse dans sa charité toutes les langues, et triomphe ainsi de la dispersion de Babel. » La même vérité est exposée dans AG 15 : « Les fidèles, qui sont réunis dans l’Église à partir de tous les peuples, « Les chrétiens, venus de tous les peuples et rassemblés dans l’Église « ne se distinguent des autres hommes ni par le gouvernement, ni par la langue, ni par les institutions de la vie de la cité » (90) ; aussi doivent-ils vivre pour Dieu et le Christ selon les usages de leur pays, pour cultiver vraiment et efficacement en bons citoyens l’amour de la patrie, en évitant cependant de manière absolue le mépris à l’égard des races étrangères, le nationalisme exacerbé, et en promouvant l’amour universel des hommes. »
Je crois que la mission ad gentes est à un tournant pour vivre la communion universelle dans et à travers la catholicité concrète. Nous voyons dans les sociétés et les Églises locales une appréciation renouvelée de leur caractère local ou de leur localité qui les identifie comme des peuples uniques. Mais nous ne sommes pas aveugles face à la tendance idéologique qui consiste à affirmer l’unicité d’un peuple par opposition à l’unicité d’autres peuples. La diversité devient une cause de division plutôt que d’enrichissement mutuel. Le fait d’être local peut conduire à l’isolement. Nous sommes revenus à Babel. Nous sommes entourés d’innombrables conflits nationaux et internationaux. Malheureusement, ces tendances destructrices ont pénétré certaines Églises locales. Parfois, l’ethnicité, l’appartenance à une caste et l’identité nationale ont une influence plus puissante que l’Évangile de l’amour universel et de la fraternité. Une activité missionnaire renouvelée devrait célébrer la présence dans les cultures locales de ce qui est bon et vrai, en accord avec l’Évangile, tout en étant humblement ouverte à la purification par le Saint-Esprit de ce qui est corrompu et faux dans nos cultures. D’un point de vue culturel, aucune Église locale ne peut se séparer des autres Églises locales par une fausse supériorité ou une fausse infériorité. Toutes les cultures ont besoin d’être purifiées et ordonnées à l’Évangile de Jésus par la docilité à l’Esprit Saint. Les Églises locales reconnaissent les unes dans les autres la foi de l’Église catholique unique dans le Seigneur unique, dans l’Esprit unique, dans l’Évangile unique, dans l’Eucharistie unique et dans le ministère apostolique unique, qui se concrétise cependant dans différentes sagesses et expressions locales. La collaboration entre missionnaires locaux et étrangers au sein d’une même Église locale concrétise la communion catholique des Églises locales. La coopération missionnaire entre les Églises locales à travers la prière, l’animation missionnaire et la contribution caritative (en particulier en ce mois missionnaire d’octobre et lors du Dimanche Missionnaire Mondial) est une manière de vivre concrètement la catholicité. L’horizon de la fraternité dans le monde se rétrécit. La mission chrétienne devrait élargir l’horizon de la communion.
2. La mission comme épiphanie du plan de salut de Dieu.
La fête de l’Épiphanie de notre Seigneur a toujours été associée à la mission universelle de l’Église. Vatican II explique pourquoi dans AG 9 : « L’activité missionnaire n’est rien d’autre et rien de moins que la manifestation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde et son histoire, dans laquelle Dieu conduit clairement à son terme, par la mission, l’histoire du salut. » La mission est un moment d’Épiphanie, une manifestation de Dieu et de son amour.
Mais il y a une autre épiphanie importante qui se produit dans la mission. Selon AG 8 : « L’activité missionnaire possède un lien intime avec la nature humaine elle-même et ses aspirations. Car en manifestant le Christ, l’Église révèle aux hommes par le fait même la vérité authentique de leur condition et de leur vocation intégrale, le Christ étant le principe et le modèle de cette humanité rénovée, pénétrée d’amour fraternel, de sincérité, d’esprit pacifique, à laquelle tous aspirent. »
À une époque où même certains croyants sont tièdes face à la nécessité de la mission et où certaines institutions sociales considèrent la mission comme une imposition de croyances destructrices de la liberté et de l’identité des personnes, nous devons redécouvrir la dimension « épiphanique » de la mission. Il s’agit d’un horizon riche en possibilités, mais aussi en défis.
L’Église est également appelée à être attentive aux opportunités de missio ad gentes que le Saint-Esprit indique à travers de nombreuses « épiphanies ». Je vais vous donner quelques exemples. Si la missio ad gentes consiste à aller vers les peuples et les nations pour leur apporter l’Évangile, regardons les personnes qui partent ou qui sont en mouvement constant vers d’autres terres. Il y a des millions de migrants, dont beaucoup sont chrétiens, à la recherche d’une vie plus sûre et plus tranquille.
La migration est une manifestation d’une activité missionnaire. Par exemple, l’évêque Paolo Martinelli m’a invité deux jours en décembre pour célébrer la messe qui fait partie de la neuvaine très pratiquée en Amérique du Sud et aux Philippines, en préparation de Noël, à Dubaï et à Abu Dhabi. Car pendant neuf jours à Dubaï, chaque jour, 30 000 migrants participent à la messe. Presque tous sont Philippins. Et puis à Abu Dhabi, 16 000 personnes vont à la messe chaque jour. Tous sont des migrants. C’est une révélation. Ils sont des missionnaires.
Comment l’Église s’engage-t-elle dans la mission ?
Que manifestons-nous ?
Que voient et entendent les gens ?
Les gens voient-ils le visage de Dieu et le visage de la véritable humanité en Jésus à travers notre engagement missionnaire ?
Il y a plus de cent millions de réfugiés qui fuient, errent, se cachent dans différentes parties du monde. Chaque jour, des millions de marins, de pêcheurs et de touristes traversent les frontières internationales. Les forêts sont rasées, les collines s’effondrent, les rivières sont polluées, les inondations descendent des montagnes et recouvrent les villes et les villages, l’air pollué passe de l’atmosphère aux poumons des hommes ; les armes de guerre volent haut et loin pour balayer des villages entiers. Les réseaux sociaux, Internet, le web, la technologie numérique pénètrent tous les secteurs de la société, remodelant les esprits et les consciences. La création se débat dans la tourmente et gémit dans l’attente de l’épiphanie de la liberté des enfants de Dieu. Voyons-nous ce que Dieu manifeste ? Voyons-nous les nouveaux prophètes qui révèlent le visage de Dieu et le visage de l’humanité d’aujourd’hui ? Voyons-nous les nouveaux missionnaires en mouvement constant que le Seigneur envoie ? Sommes-nous prompts à nous plaindre du manque de vocations, mais lents à voir l’épiphanie de nouvelles vocations ? Je ne fais que poser la question.
3. Études missiologiques
Le Concile Vatican II reconnaît la vocation particulière de ceux qui sont appelés à la mission, en particulier dans AG 23 : « Ils sont en effet marqués d’une vocation spéciale, ceux qui, doués d’un caractère naturel approprié, ayant les aptitudes requises en raison de leurs qualités et de leur intelligence, sont prêts à assumer l’œuvre missionnaire, qu’ils soient autochtones ou étrangers. »
Chaque don de Dieu doit être reconnu, cultivé et équipé pour le service que ce don doit rendre. C’est pourquoi Vatican II demande une formation solide et étendue pour les missionnaires ad gentes. Ils devraient être préparés comme ceux qui sont engagés dans d’autres ministères de l’Église, sinon davantage. Je cite AG 26 : « Il est donc indispensable que le futur missionnaire suive des études de missiologie, c’est-à-dire qu’il connaisse la doctrine et les normes de l’Église relatives à l’activité missionnaire, qu’il sache quelles voies ont été suivies au cours des siècles par les messagers de l’Évangile, qu’il soit au courant de la situation missionnaire actuelle et des méthodes considérées aujourd’hui comme les plus efficaces. » Dans AG 34, il est dit : « L’exercice régulier et ordonné de l’activité missionnaire exigeant que les ouvriers évangéliques soient préparés scientifiquement à leur mission, particulièrement au dialogue avec les religions et les cultures non chrétiennes, – et que dans l’exécution elle-même ils soient aidés efficacement, on désire que, en faveur des missions, collaborent fraternellement et généreusement entre eux les divers instituts scientifiques qui cultivent la missiologie et d’autres disciplines ou techniques utiles aux missions, comme l’ethnologie et la linguistique, l’histoire et la science des religions, la sociologie, les techniques pastorales, et autres choses semblables. »
Soixante ans après la promulgation de Ad gentes, j’ai l’impression que certaines institutions éducatives catholiques, pour diverses raisons, n’accordent pas aux études missiologiques le statut que Vatican II entendait leur attribuer. Mais si l’Église est missionnaire par nature, alors la préparation spirituelle, humaine, pastorale et intellectuelle à la mission devrait être une priorité naturelle, surtout si l’on considère le terrain missionnaire changeant de notre monde contemporain. Je dirais même que toutes les disciplines ecclésiastiques devraient avoir une impulsion pastorale missionnaire.
La réforme de la Curie romaine de 2022 avec le Praedicate Evangelium a créé le nouveau Dicastère pour l’Évangélisation avec deux sections. Pendant Vatican II, il s’appelait Congrégation Propaganda Fide. L’AG 29 dit : « Pour toutes les missions et pour toute l’activité missionnaire, il faut qu’il n’y ait qu’un seul dicastère compétent, celui de la « Propagation de la foi », par lequel doivent être dirigées et coordonnées par toute la terre l’œuvre missionnaire et la coopération missionnaire cependant le droit des Églises orientales, étant sauf. »
Le Dicastère pour l’Évangélisation, la Section pour la Première Évangélisation et les Jeunes Églises particulières, avec l’Université Pontificale Urbanienne et les facultés ecclésiastiques qui lui sont affiliées, les quatre Œuvres Pontificales Missionnaires et les Collèges pontificaux sous la responsabilité du Dicastère, renouvellent leur engagement envers le mandat reçu du Concile Vatican II, en particulier dans la promotion d’études missiologiques solides qui s’engagent avec courage et créativité dans les horizons émergents de la missio ad gentes aujourd’hui.
(Agence Fides 5/10/2025)