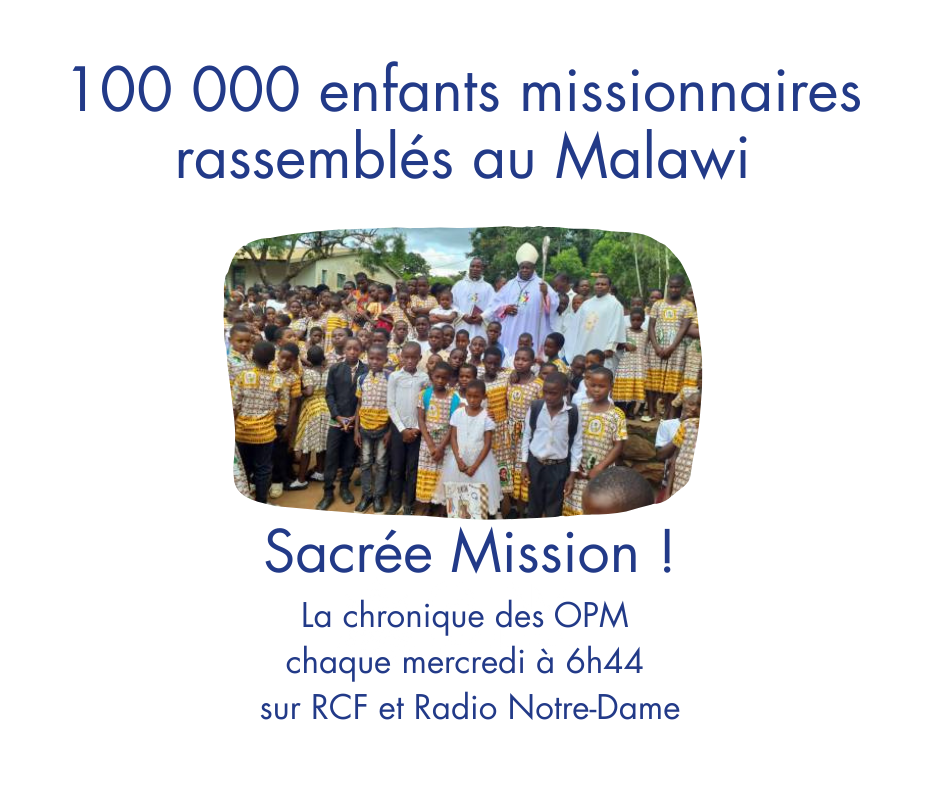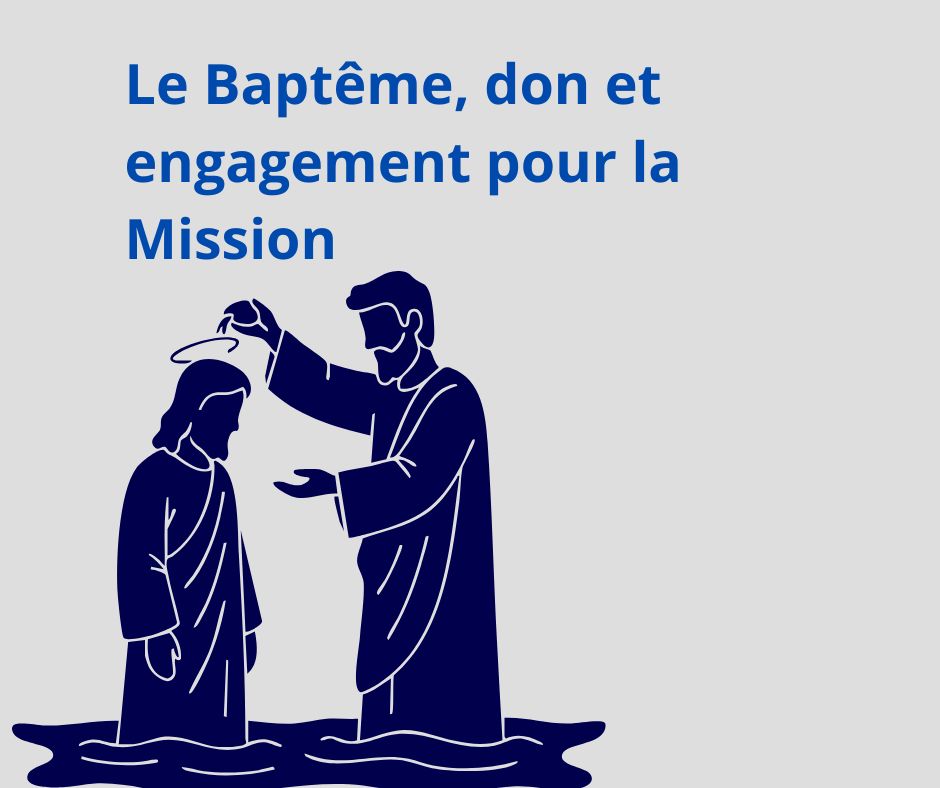Chaque dimanche ou Solennité, le Père Anh Nhue Nguyen, secrétaire général à Rome de l’Union Pontificale Missionnaire, livre à notre réflexion son commentaire missionnaire biblique.
17e dimanche du TO (année C). Textes : Gn 18, 20-32 ; Ps 137 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-13
Comme les deux derniers dimanches, aujourd’hui encore l’Evangile nous met à l’école du Christ pour apprendre de lui un autre aspect fondamental de la vie d’un disciple lui : l’action de prier ou simplement le prier. Ici, j’utilise intentionnellement le verbe et non le substantif (prière), car l’enseignement de Jésus à ce sujet dans le passage de l’Évangile d’aujourd’hui semble vouloir non pas nécessairement clarifier le concept dans l’esprit des disciples, mais les aider à prendre l’habitude de prier en eux-mêmes, comme le pratiquait leur maître. Ce n’est pas un hasard si saint Luc, le seul parmi les évangélistes, souligne que tout part d’un contexte temporel particulier : « Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : ” Seigneur, apprends-nous à prier “». L’occasion était donc propice pour le Maître de Nazareth de communiquer à ses disciples, par l’exemple et par la parole, les trois points essentiels à suivre dans leurs prières.
1. « Père, ton règne vienne » : la priorité de prier pour la venue du Règne de Dieu
En premier lieu, Jésus enseigne à ses disciples à prier Dieu avec un court texte, appelé plus tard dans la tradition chrétienne la prière du Notre Père. Contrairement à la version de l’Évangile de Matthieu utilisée dans la liturgie de l’Église, celle de Luc est plus courte et ne contient que cinq invocations (au lieu de sept comme en Matthieu) : deux concernent la réalité divine et trois la réalité humaine. Chaque phrase de ce précieux et unique texte de prière, que Jésus a enseigné à ses disciples, contient une immense richesse à découvrir et à approfondir (pour cela je vous invite à lire la partie consacrée au Notre Père dans le Catéchisme de l’Église catholique [nn .2803 et suivants]). Nous ne rappelons ici qu’un aspect, le plus important concernant le caractère « missionnaire ».
En effet, dans les deux versions, après s’être adressé à Dieu avec l’appellation « Père », qui place l’orant dans une relation filiale particulière avec Dieu, la prière commence par deux demandes parallèles : celle de la sanctification de son nom et celle de la venue de son royaume. Ils sont en quelque sorte complémentaires, car là où Dieu règne, son “nom”, c’est-à-dire lui-même, est “sanctifié” et “glorifié”, c’est-à-dire reconnu comme saint et adoré comme tel (cf. Catéchisme de la Église catholique n° 2807). Dans ces premières invocations, nous pouvons entrevoir le grand désir de la cause de Dieu que Jésus portait constamment dans son cœur et qu’il veut maintenant transmettre à ses disciples. Lui-même a proclamé dès le début de ses activités publiques que “le règne de Dieu s’est approché” ou mieux “s’est approché” de façon dynamique.
Il convient de préciser que l’avènement du royaume de Dieu ne signifie pas l’établissement d’un territoire aux frontières visibles et sous contrôle. Cette venue implique plutôt la réalité/action que Dieu règne sur son peuple et, en général, dans le cœur des hommes et des femmes, précisément conformément à la tradition de l’Ancien Testament (qui utilise l’expression verbale “Dieu règne” bien plus que fréquemment de la “règne de Dieu”). Les mêmes textes de l’Ancien Testament expriment aussi l’attente du jour où Dieu viendra régner sur tout et sur tous. Ainsi, l’invocation de la venue du royaume de Dieu demande en réalité que Dieu réalise son dessein de salut dans le monde.
Le Notre Père se révèle donc avant tout comme une prière « missionnaire ». Ceux qui prient partagent le même désir de Dieu, qui est aussi celui du Christ, pour l’accomplissement de la missio Dei, cette mission de Dieu pour le bonheur de l’homme, qui a maintenant atteint la plénitude des temps avec la venue de Jésus, qui le prient souhaitent aussi pour lui-même et pour toute l’humanité le doux “joug du royaume”, que Dieu règne dans sa vie, ainsi que dans la vie de chaque homme et femme dans le monde. Cette prière est la première action de la mission par excellence.
2. Priez avec insistance et confiance filiale
Deuxièmement, Jésus enseigne à prier Dieu avec insistance (« intrusion ») et confiance filiale. Il le fait à travers une courte parabole, qui reflète divers aspects de la culture de son peuple : l’arrivée d’un ami sans préavis « à minuit » d’un voyage (il n’y avait certainement pas de téléphone portable à cette époque), rester au lit avec ou près des enfants (selon la structure de la maison de l’époque), d’où la peur de les réveiller, et surtout le fait étrange que le propriétaire de la maison n’ait pas pensé à la possibilité de punir son ami intrusif en appelant la police ».
En tout cas, comme le montre le contexte littéraire, l’attitude d’insistance dans la prière semble recommandée non pas tant pour chaque besoin de la personne qui prie (parfois seulement selon ses désirs humains), que précisément en vue de la demande des choses essentielles que Jésus avait enseignées dans le Notre Père, surtout cette invocation pour le royaume. Cette perspective s’appliquera également à l’affirmation de Jésus plus tard (qui a été mal comprise et abusée à plusieurs reprises) :« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira » (Lc 11,9-10). Que demander, chercher, et chez qui frapper la porte? Il est important de rappeler à ce propos la recommandation même de Jésus: « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6,33).
3. « Prière » entièrement orientée vers le don du Saint-Esprit
Enfin, Jésus conclut sa « catéchèse » sur la prière avec l’indication de l’Esprit Saint comme le bien suprême à demander et à recevoir de Dieu : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » (Lc 11,13). Cela se laisse déjà entrevoir par le parallélisme entre les “bonnes choses” qu’un père terrestre sait donner à ses enfants et “l’Esprit Saint” que le Père céleste donnera à ceux qui le demandent. La pensée émerge encore plus clairement, si l’on compare cette version des paroles de Jésus avec celle de l’Évangile de Matthieu qui rend le paroles plus linéaire, plus logique : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! » (Mt 7,11).
Ainsi, l’enseignement de Jésus dans la version lucanienne est encore plus riche, car il oriente tout vers le plus grand don que Dieu accorde à l’homme : l’Esprit Saint qui purifie, sanctifie et guide l’homme dans la vie avec Dieu et en Dieu. L’Esprit est, il y a Dieu présent qui règne ; le royaume de Dieu y est présent, c’est pourquoi prier Dieu pour le don du Saint-Esprit revient en fait à prier pour l’avènement du royaume de Dieu en nous-mêmes. Ce sera aussi l’Esprit qui nous aidera à entrer toujours plus dans la relation filiale avec Dieu que nous appelons désormais « Abba ! “, c’est-à-dire : Père ! » (Cf. Rm 8, 15-16), comme Jésus nous l’a enseigné.
Nous demandons donc que ce don suprême de Dieu qu’est l’Esprit Saint nous soit donné toujours et aussi aujourd’hui, avec la certitude que Dieu notre Père céleste nous le donnera. Et “guidés par l’Esprit de Jésus”, nous pouvons élever chaque jour vers le Père les invocations essentielles de la prière du Notre Père avec insistance et confiance filiale, plaidant avec une force particulière pour que le Royaume de Dieu vienne parmi nous. Amen.